Les acouphènes du malheur

Les amateurs de musique et les musicologues sont intrigués par l’ouverture peu orthodoxe de la Première Symphonie de Mahler – un la joué sur six octaves et noté pianississimo (ppp). Aucune note n’avait suscité une telle perplexité depuis la dissonance de la Septième Symphonie de Beethoven.
[…] L’inspiration de l’ouverture se comprend peut-être mieux d’un point de vue technique. Comme le savent tous ceux qui ont collé l’oreille à un coquillage ou à une bouteille vide, chaque corps semi-fermé produit une sorte de sifflement associé à sa fréquence de résonance. Fait intéressant, la note la plus aiguë de l’accord de Mahler est le dernier la d’un piano de 88 notes, dont la fréquence fondamentale est de 3 520 Hz. Cette fréquence, comme par hasard, se situe dans le champ de sensibilité de l’ouïe humaine associé à la fréquence de résonance de la cavité de l’oreille externe. Se pourrait-il que Mahler ait été au diapason de cette fréquence de résonance ? Ce serait possible : les quatre membres d’une chorale que j’ai interrogés ont dit percevoir un faible tintement aigu autour du la de 3 520 Hz.
Par ailleurs, la note de 3 520 Hz est peu éloignée de la gamme des fréquences acceptables (de 4000 à 8000 Hz) du phénomène appelé acouphène. Se pourrait-il que de légers acouphènes aient inspiré à Mahler son emploi du la aigu ? On ne trouve aucune indication en ce sens dans sa biographie, mais vu la durée aussi soutenue des la, une telle hypothèse n’est pas à négliger.
On sait que Mahler était un penseur qui composait dans la solitude. Ces deux possibilités – de fréquence de résonance de l’oreille externe et d’acouphènes – soulèvent diverses questions qui mènent toutes cependant à la même conclusion : Mahler a choisi de commencer sa première symphonie avec un son qui repose sur le silence.
[Traduction d’Alain Cavenne]
A méditer (lire l’article complet) sur www.scena.org…





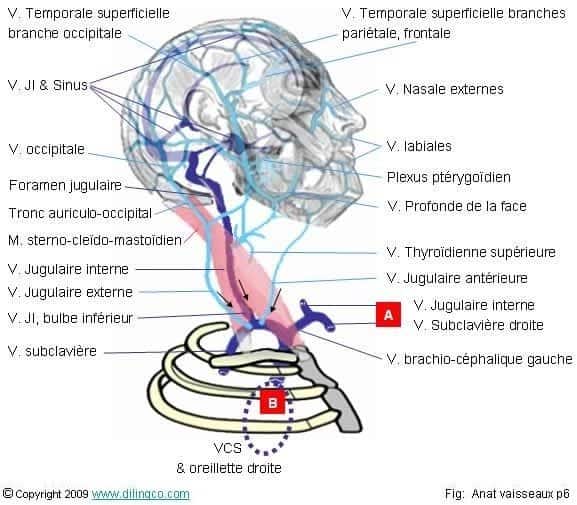

Réponses